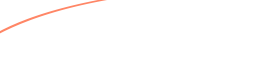- 2018 – Infinir les choses (Untitled Magazine) par Sandra Barré
- 2017 – Umbrarum Mathematica (Revue Inferno) par Smaranda Olcèse
- 2016 – The Poetry of Mathematics (Varsity) par Jade Cuttle
- 2015 – Art, amour et mathématiques (Magazine du Palais de Tokyo, 21)
- 2015 – Entretien Le bord des mondes (Revue Inferno)
- 2014 – France Culture & Aude Lavigne
- 2013 – Méridien Etoile & Tokyo Art Club
- 2013 – Fragments de mathématiques existentielles (Revue de Synthèse) par Baptiste Mélès
- 2013 – Le Cristal de Sublimation par Gilbert Kieffer (ONPhI)
2013 – Le Cristal de Sublimation
par Gilbert Kieffer (ONPhI)
Le Cristal de sublimation ou la magie des mathématiques existentielles de Laurent Derobert
Cristal et sublimation, ce sont des images que Laurent Derobert lui-même utilise quand il parle du rapport des formules mathématiques à leur passage à l’existentiel, depuis la dureté concise et ramassée de leur écriture abstraite proprement transparente, jusqu’à ce état d’évanescence, changeant, vaporeux et divers, de l’existentiel humain dont l’amour est le plus indescriptible… et c’est encore peu dire, car… justement cette sublimation parfaite, ce passage de l’état solide des transparences mathématiques vers l’insaisissable humain doit… pour se dire à nous passer par… le langage humain, par ce verbe même, qui parfois devance la parole comme le dit Heidegger, mais pour cette fois paraît quelque peu surnuméraire, liquide donc pour en revenir à l’image, et brise de ce fait encore l’effet la sublimation dans son effectivité première. Mais cela dit comme un préalable pour lui et pour moi, voyons en quoi l’image d’une sublimation par le cristal pourrait avoir un pouvoir particulier d’approche de ce penseur si étrange.
Le cristal comme figure de l’imaginaire bachelardien.
Je me suis longtemps amusé à compléter le tableau des rêveries mendeleieviennes de l’imaginaire de Bachelard. De fait, comme Mendeleiev qui a classé les valences chimiques de manière à penser même les trans-uraniens, Bachelard lui a fait un classement similaire pour les figures de la rêverie. Il était conduit par une lumineuse intuition : L’esprit scientifique est toujours en lutte contre d’anciennes images : Lavoisier détruit définitivement plus de deux mille années de certitudes en s’attaquant à l’un des 4 éléments : l’air. Il le décompose et le mesure c’est le début de la pondérabilité, mais c’est définitivement la fin de l’air comme élément. Il ne lui reste plus alors qu’à survivre dans la poésie. Il y a ainsi, dans l’imaginaire, un ensemble d’images du même type. Bachelard pense qu’elles devraient être psychanalysées pour libérer et rajeunir l’esprit à de nouveaux possibles rationnels. C’est cette opération de psychanalyse jungienne et husserlienne à la fois qu’il entreprend. Mais il se trouve alors très vite pris au jeu de ces images hypnotiques, quand il en fait le catalogue mendeleievien. Observant combien l’esprit rationnel a dû lutter pour se frayer une route dans coeur de l’évidence des rêveries, Bachelard en a relevé les figures essentielles en les nommant. Dans la Terre et les rêveries de la volonté, parmi toutes les rêveries de l’homo faber et de la phénoménologie des matières résistantes il y a celle du cristal dans sa dureté et sa transparence. Présentée comme un vestige du ciel, la rêverie du cristal est une constante de l’imaginaire éveillé. Elle apparaît comme une évidence de dureté, de pureté, de pérennité et de transparence. Elle anime les énergies dures, celles qui résistent. Elle hante les mathématiques de Laurent Robert quand elles affrontent l’être ondoyant et divers, de subtile essence et fragile présence dans un équilibre dont ces mêmes mathématiques cherchent à transcrire l’instable essence par la formule de Dédale, le sculpteur de soi, le constructeur du labyrinthe et d’autres qui quêtent au coeur du cristal l’énergie des images premières, archétypales. Et on a l’impression d’être encore une fois guidé par le fil d’Ariane à rechercher les algorithmes du bonheur dans un espace d’équilibre menacé par les algorithme de l’Autre, dans des formules générales. Je ne sais quelle subtile poésie habite ce langage ! Peut-être parce qu’il est hypnotique justement. Et il est hypnotique parce qu’il fixe tellement notre attention quand il mobilise intensément l’esprit à suivre un langage abstrait aux antipodes de la rêverie, et que le saisissant ainsi, il le libère en même temps pour de plus profondes rêveries encore, des rêveries poétiques assurément, de celles qui nous montrent le monde comme si on le voyait pour la première fois. Car il s’agit bien de décrire cette phénoménologie par une sorte d’état modifié de la conscience, qui s’obtient, ou bien par une musique prenante, ou bien par une parole hypnotique, par une image, mais aussi par des formules dans l’essence desquelles on chercherait le coeur de l’existence et qui nous demanderaient tant d’efforts à les suivre, que l’on soit mathématicien ou non (car mêmes pour le mathématicien elles disent des choses qu’elles ne devraient pas dire, elles sortent de leur cadre Popperien), tant d’efforts que notre conscience commune s’endort et que l’on entre dans une légère transe qui est le signe le plus sûr de l’art et que naguère on nommait simplement émotion. C’est en réalité un état modifié de la conscience par lequel ce qui est là, paraît étrange et familier à la fois. C’est comme si on connaissait tout cela, mais qu’on le voyait pourtant pour la première fois. C’est cette essence que traquent les formules de Laurent Derobert à frôler ainsi la vie comme pour la faire apparaître sous le premier jour de sa nouvelle présence. Et c’est un peu ce que l’on ressent quand Verlaine dit :
Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant / D’une femme inconnue, et que j’aime, et qui m’aime / Et qui n’est, chaque fois, ni tout à fait la même / Ni tout à fait une autre, et m’aime et me comprend.
Et c’est l’essence de l’art et de l’amour qui se décrit dans sa jeunesse éternelle, dont le pouvoir est justement de nous éveiller à l’émotion comme si on rencontrait cette impression pour la première fois. Et c’est par l’effet d’une fascination de quelques notes envoûtantes, de quelques mots calibrés qui fixent subitement notre attention et nous ouvrent au frisson. Et l’on sent le bonheur de cet artisan de l’abstrait qui cisèle une formule, la reconstruit, quand, subitement lui apparaît un nouveau paramètre de l’amour, alors qu’il cherchait à décrire l’équilibre et la solitude du rêve au coeur du monde. Et c’est à chaque fois de ces choses dont on a une certaine expérience et qui ne sont jamais « les mêmes » lorsqu’elles nous arrivent vêtues de ces formules solennelles et froides qu’elles contribuent ainsi à réchauffer pour un instant. Et c’est un peu toute notre conscience qui se surprend ainsi à espérer l’essence de l’éphémère… comme dans la phrase de Vinteuil lorsque Swann l’écoute et qu’il sent la souffrance lointaine se réveiller dans ce petit morceau de fausse éternité qui revit dans sa formule, avant que la magie ne s’éteigne, pareille dans le fond à ces veilleuses de Proust. « Peut-être est-ce le néant qui est le vrai et tout notre rêve est-il inexistant, mais alors nous sentons qu’il faudra que ces phrases musicales, ces notions qui existent par rapport à lui, ne soient rien non plus. Nous périrons mais nous avons pour otages ces captives divines qui suivront notre chance. Et la mort avec elles a quelque chose de moins amer, de moins inglorieux, peut-être de moins probable. »
Et c’est le même plaisir de rêver, qui habite de nouveau les choses dures et transparentes, quand elles parlent de nous, de notre essence éphémère. Et c’est également le langage de l’art, dans son ephémère et tranquillisante présence, qui nous touche comme au premier jour de sa toute première magie hypnotique. Mais c’est encore de sublimation qu’il faudra parler dans tout cela.
La sublimation post-freudienne d’un langage sans langage.
Le mot « sublimation » nous vient d’un autre horizon. Il nous parle depuis l’alchimie, depuis cette période lointaine, dont Bachelard était le spécialiste, cette période fondatrice qui n’avait pas encore recours à la psychanalyse de ses images. En cette période d’intense activité de l’imaginaire, la recherche de la pierre philosophale était une opération multiple qui englobait de nombreux rêves humains, qui devraient plus tard se réaliser par d’autres moyens. L’alchimie était le creuset de notre philosophie avec elle ou contre elle, d’une part de notre théologie, de nos espoirs scientifiques aussi. De là ces concepts qui ont survécu en se purifiant, en se sublimant comme celui de sublimation lui-même. C’est un réseau qui dépasse de loin le jeu des connaissances et de ses errements, pour toucher l’être en son intimité essentielle, à la confluence de tous les savoirs ésotériques également, héritier de traditions oubliées qui nous ont constitués, celle lointaine des Egyptiens, des mystères d’Eleusis, et d’autres plus récentes et toujours récurrentes. Il y a là après l’Oeuvre au noir de la calcination, après l’Oeuvre au blanc du lavage ou de la purification, l’Oeuvre au jaune de la sublimation, de la vaporisation. C’est là, avec cette troisième étape de sublimation que commence le Grand Oeuvre des alchimistes, c’est à dire au fond la rêverie d’une intertion cosmique, qui se termine par l’Oeuvre au rouge. Et c’est déjà une longue rêverie, venue de très loin et qui engage l’être tout entier dans sa dimension personnelle et cosmique, par l’intermédiaire d’opérations alchimiques (il est vrai, rudimentaires pour nous maintenant). Mais dans tout cela il y a surtout la densité des rêves qui importe. Et c’est celle qu’il convient de psychanalyser pour en arriver à la purification de l’être. Alors tout se décante à la fin autour des concepts jungiens revus par Bachelard de cet animus qui cisèle les formes dures, se concentre en sentences, en formules, se détachant de cette autre part de lui-même, de cette anima de rêves féminins, de rêveries cosmiques et lunaires. Là se dessinent les passages et les conciliations de la sublimation de l’âme féminine en l’homme et de l’âme masculine en la femme. Et le 3e des 4 niveaux de cette anima est pour Jung justement à nouveau la figure de sublimation dans une dimension religieuse. C’est le 3e degré d’évolution d’anima qui en compte 4. Et c’est ainsi que l’on en revient aux mathématiques, à la ciselure d’animus, à la précision transparente de son langage… qui dialogue avec anima dans les profondeurs du sens, au coeur d’une sublimation jungienne et bachelardienne qui cherche à préserver l’énergie de la psyché, sa dimension féminine, féconde de songes et de rêveries, mais des rêveries enserrées par des formules denses qui hypnotisent justement parce qu’elle traquent l’anima cachée, inavouée et peut-être interdite.
Et l’on songe finalement également à Freud, à son propre travail de sublimation, à la manière dont il a consciemment intégré ce terme de la physique à la psychologie de l’inconscient. En physique, ce passage direct d’un état solide à l’état gazeux sans passer par l’état liquide que décrit la sublimation, Freud l’employait donc pour désigner le nouvel effet de catharsis qu’il avait pu observer dans le mécanisme de l’esprit. Je dis bien nouvel, car l’ancien effet remontait à plus de deux mille ans ; il avait été nommé par Aristote. Il désignait le travail de l’acteur, qui jouant la passion la déconstruisait en même temps pour le spectateur. C’était un mécanisme mimétique qui devait dépotentialiser les passions par « Einfühlung » et travailler en faveur d’une harmonie civique, « politique ». Chez Freud et après lui, surtout par le travail des surréalistes, que Freud lui-même n’a pas vraiment compris, la nouvelle catharsis appelée sublimation, devait, en se généralisant encore parler du processus de l’art tout entier, cet art capable de corriger la vie, de racheter les souffrances, de purifier les peurs et les angoisses, cette fois dans sa seule dimension individuelle, et c’est ce qui nous intéresse justement. Cette nouvelle sublimation mettait hors de portée les symboles profonds, personnels, secrets, pour mieux les protéger, en les plaçant un étage plus haut sans que l’on sente le passage, dans l’oeuvre d’art qui convertira son énergie, permettant à l’être de vivre de légères névroses d’accomplissement et de complétude, tout en ne reniant pas l’énergie pulsionnelle qui en est le coeur.
Et l’on pense alors clairement à rebours, ce tissage de l’esprit qui voile et dévoile dans un processus d’aletheia ce qu’il veut retenir et non clairement révéler. C’est donc probablement aussi un travail de psychanalyse active que l’on fait en faisant des mathématiques existentielles sur ces expériences humaines que l’on cherche à percer et à surmonter, et à travers elles des couches du moi qu’il faut encore concilier.
Des mathématiques de ce type sont des oeuvres de l’Art tout en étant quelque part une psychanalyse active de leur inventeur, car… et on le sent bien, elles sont alors parfois aussi un refuge et une dérivation supérieure de la vie. Et c’est toute leur fragilité que nous aimons dans le travail Laurent Robert. Car comme les métaphores surréalistes, elles échapperont par leur langage au langage courant de la parole, chargé de topoi lourds et communs dont l’énergie a fui. C’est qu’il doit se faire bigrement léger pour approcher la magie de la dureté sublimée, la magie du cristal sublimé. Je les place décidément ensemble à présent et quand j’évoquerai les mathématiques existentielles je les définirai par la figure absente dans la cartographie de l’imaginaire bachelardien : celle du cristal sublimé.
Dr Gilbert Kieffer, Santo Domingo novembre 2013
2012 – Singularité universelle
(Revue Mouvement) par Matthias Cléry
http://www.mouvement.net/critiques/critiques/singularite-universelle
Laurent Derobert et Ryoji Ikeda investissent le champ mathématique comme un langage ou une esthétique. Leurs travaux, estompant la frontière entre l’être et l’idée, font surgir dans le monde, comme pour la première fois, le « Je ».
En regard des « mathématiques de l’avoir » de l’économie, en fonder une « de l’être ». Laurent Derobert, dans ses mathématiques existentielles(1), utilise intégrales, dérivées et limites pour façonner des concepts précis. Ainsi formulés, ils deviennent universels. Les références aux formules newtoniennes et au calcul différentiel honorent tout autant la vacuité du symbole mathématique que sa force conceptuelle.
Pour autant c’est bien du sujet singulier dont il est question. Prenant au pied de la lettre l’enseignement de Protagoras, Derobert fait de l’homme la mesure de toute chose. Il appartient à chacun de définir les êtres (rêvés, vécus, réels) que nous sommes ou qui habitent notre monde et les distances qui les séparent. Le problème paradigmatique consiste à minimiser son dédale, somme pondérée des distances entre les êtres du sujet et du monde. Une telle structure intéresse autant mathématiciens et physiciens (qui participent à un second tome sur le sujet) que psychologues et sociologues. Elle rompt avec les concepts topologiques usuels d’une distance conçue absolument sur un ensemble (alors appelé espace métrique), et offre ce qui ressemble à une science du soi par soi, porteuse d’une ouverture sur la question de la scientificité de la psychanalyse.
La conception de théorèmes repose sur l’analyse d’expériences personnelles recueillies au cours d’entretiens pour « précipiter dans une formule » la singularité de l’individu. Nos tendances masochistes, notre schizophrénie, nos envols icariens prennent la forme d’égalités, d’inégalités ou de systèmes d’équations. Notre passion réduit le monde extérieur à un être aimé. La variable d’Ariane lie l’amour porté et l’amour reçu et conditionne notre bonheur. La forme symbolique est un squelette, il appartient à chacun de nous d’en sculpter la chair. Laurent Derobert nous raconte une histoire, la nôtre :
« Ce sont des mathématiques expressives voire peut-être expressionnistes, qui n’ont rien d’explicatives ou de prédictives. » La formule interrompt le verbe (qu’on sache ou non la lire) et invite à l’introspection et à l’imagination. Chacune, accompagnée d’un sous-titre, se présente sous la forme d’un Haïku : « vitesse de fantômisation de l’être », « enchevêtrement des dédales passionnels », « force d’attraction de l’être rêvé ». Notre dédale manque toujours son minimum et navigue entre le seuil de Verlaine et le plafond de Rimbaud. Au-delà des limites de la poésie, « l’explosion du dédale est très probable ».
En choisissant de projeter sept formules dans le cellier du Collège des Bernardins(2), Alain Berland (Chargé des arts plastiques) rend compte de cette « émouvante mathématique ». L’exposition prend la forme d’un « parcours méditatif, en face des salles de cours où la pensée s’effectue, conduisant à la bibliothèque où la pensée se conserve », suggère-t-il.
L’être, sous la plume de Derobert, s’incarne dans des formules et leur donne un sens étonnamment poétique. La rencontre entre sa philosophie et les mathématiques passe ainsi par une substitution conceptuelle dans ce langage scientifique laissé intact.
Dans un monde où les mathématiques semblent avoir gagné le statut de langage du réel, des œuvres peuvent tirer parti des concepts mathématiques.
« Les mathématiques ne s’illustrent pas, elles ne s’utilisent pas pour faire de l’art. Elles sont en quelque sorte un art. » Ryoji Ikeda(3), reprenant la tradition pythagoricienne, amalgame cette science et la musique en un même corps. L’abstraction du son, jamais signifiant sans contexte, appelle à une abstraction mathématique. Et cet artiste japonais de rendre valide la réciproque. Ainsi étudie-t-il le son des données (« sound of data ») et les données du son (« data of sound ») dans Dataphonics(4), diffusé sous la forme d’un feuilleton dans l’Atelier de création radiophonique de France culture de 2006 à 2007.
Le « sens mathématique » est une pierre angulaire dans son œuvre. Jouant de l’ambiguïté du mot sens, il donne à entendre et à voir quelque chose de l’ordre de l’algèbre et de la logique. Dans V L, les décimales d’un nombre transcendant (c’est-à-dire qui n’est pas solution d’une équation polynomiale à coefficients fractionnaires ou entiers) comme ou s’impriment sur du papier ou défilent sur un écran. Dans Matrix, il nous fait interagir avec le son d’une courbe sinusoïdale et d’un processus stochastique continu (ou bruit blanc). Inexorablement, l’expérience sensible que nous propose Ikeda nous mène aux limites de la compréhension. Ses compositions inspirent sensations, interprétations et jugements toujours personnels. C’est bel et bien seul qu’on se retrouve devant le travail de Ryoji Ikeda.
L’artiste se refuse à caractériser l’esthétique mathématique qu’il revendique pourtant, pas plus ne souhaite-t-il définir celle de sa musique. Les mots, laisse-t-il entendre, sont toujours en défaut pour rendre compte de ces deux choses. Cependant, pour le philosophe Alain Badiou(5), les mathématiques suivent une esthétique régie par trois principes. Une théorie doit faire l’économie de ses axiomes, opérer une totalisation rationnelle (en englobant un maximum de résultats connus) et être féconde en trouvant des conséquences hors du domaine immédiat de sa formulation.
Ces principes sont bien présents dans l’œuvre de l’artiste japonais. L’outil de travail d’Ikeda se limite le plus souvent à son ordinateur, ses installations sont minimalistes (cinq haut-parleurs pour Matrix, des projecteurs de lumière blanches pour Spectra), Ikeda est dans l’économie des moyens. Transformant textes et images (Test pattern), exposant une controverse de la théorie des ensembles (V L), il récupère des domaines loin du son ou de l’image dont ils témoignent. Enfin, s’adressant à l’individu, multipliant les médias et déclinant ses travaux sous différentes formes, ses œuvres fertiles ouvrent à un infini subjectif.
Les supports privilégiés d’Ikeda marquent néanmoins son dépassement d’une telle esthétique. Confrontant nos sens à des êtres immatériels, comme le son et la lumière, il réussit à nous faire prendre conscience de la forme et de l’ordre que notre monde intérieur leur imprime. Avec db, la frontière entre l’idée et la matière se dissout dans les fréquences limites de la perception humaine.
1. Laurent Derobert, Fragments de mathématiques existentielles, Delirium, 2010.
2. L’exposition Fragments de mathématiques existentielles s’est tenue du 12 octobre au 18 décembre au Collège des Bernardins, Paris, dans le cadre du cycle « Questions d’artistes ».
3. Ryoji Ikeda exposera une installation inédite à la Gaîté Lyrique, Paris, dans le cadre du Festival d’Automne 2012.
4. Conférence « Mathématiques/Esthétiques/Arts », Alain Badiou, 16 juin 2011, Centre Pompidou, Paris, consultable sur Dailymotion.
5- Idem.
Artiste(s) :
Laurent Derobert chercheur
Ikeda Ryoji artiste
Matthias Cléry rédacteur
2012 – Commentaires des Fragments
par Jacques Roux, psychiatre
Regrettant vivement de n’avoir pu participer à la présentation de cet ouvrage à l’UPAvignon, j’en dépose ici un commentaire qui aura pour fonction, outre de compenser mon absence et le plaisir perdu, de prolonger un débat, et d’en maintenir la possibilité.
Le texte extraordinaire et extraordinairement esthétique, éthique, et thétique de Laurent Derobert dont j’ai lu la substance sur la partie en ligne sur le site de L’UPA, m’évoque un certain nombre de commentaires que je ne résiste pas au plaisir d’exprimer sur cette page tout aussi fictive que les précédentes.
Ce document troublant et innovant dans le domaine de la logique et de la « mathesis » aussi bien existentielle qu’intellectuelle, m’interroge et me charme.
D’abord par sa complétude rhétorique, poétique et dialectique, mais aussi par son audace intellectuelle à affronter le fantasme d’une explication possible de l’être humain, de ses passions, et de ses stratégies.
Par la maîtrise des savoirs de l’écriture mathématique (ou des écritures mathématiques).
Enfin parce qu’il s’adresse à des problèmes et à des questions sur lesquels je m’évertue depuis bien longtemps et avec beaucoup moins de moyens, à reprendre par définitions, par axiomes et quelques vues si possibles critiques, en tout cas susceptibles de permettre un degré minimum d’émancipation de mes petites angoisses et de mes petites questions psychologiques personnelles, sinon métaphysiques.
Il m’interroge par la forme de par son développement, sur une vision de l’être de la métaphysique qui n’est, si j’ai bien compris, pas si différent que ça de l’être « psychique » de l’aliéné moyen, en un mot, du quidam, qui pense, un peu, pas seulement à l’école, ou à la télé, mais un peu aussi dans l’exercice de sa propre existence sociale.
Quelles questions m’a donc posé ce texte ?
Essayons de les sérier :
– Tout d’abord il parle de la passion. Pas d’emblée, mais pas non plus d’une façon marginale. Il me semble même passionné par la passion, ce qui, grand Dieu, n’est pas un défaut, ni une erreur. Et parmi les passions, il traite essentiellement la question du rapport des amants. On pourrait s’interroger sur la place laissée au rôle de la passion des amants dont le rapport ne se fait pas.
– Mais autant que la question des amants, ce texte présente une version logique de la position du Sadique et du Masochiste, ce qui à ma connaissance n’a été proposé nulle part. : « Est sadique celui qui réduit son dédale quand s’accroît le dédale d’autrui.» Si j’en juge par ma compréhension du « système » de cette « mathématique existentielle », il aurait donc tendance, le même sadique, à accroître son « vestale » quand celui d’autrui se délite. Au fond, il arrange ses affaires en général au détriment de cet autrui qui pourrait lui poser le problème de la passion, mais que le temps ne lui laisse pas loisir d’investir comme interlocuteur, une fois passée l’étape déterminante du rapport sexuel imaginaire ou intellectuel.
– Qui donc aujourd’hui garanti quelque rigueur dans la connaissance du fait pervers ? Le psychanalyste tapi dans son échoppe (mais il ne les cherche pas comme clients)? Le psychiatre expert garanti par sa « formation universitaire » et son expérience protégée par les murs du service de force (mais les DSM éradique de son champ de compétence toutes les « perversions ») ? Le flic de quartier dont on ne doute pas qu’il soit en contact avec un certain nombre de pervers, de part et d’autre de la « barrière » du jugement positif et du jugement social ? Le juge chez lequel de toute façon la fonction de jugement émancipe de la nécessité de comprendre et d’expliquer … la perversion ? Le metteur en scène de films policiers dont on ne doute pas que l’intérêt pour la perversion est d’autant plus grand que le statu de producteur de média lui permet de se tenir plus loin des personnages réels qu’il décrit sous cette rubrique ? Bien sûr que je ne puis répondre à ces questions, mais je soutiens vivement comme c’est le cas ici, que toute démarche qui « ose » une incursion théorique non « comportementaliste » et non protégée par le manteau d’une « philosophie analytique », dans les espaces infinis et plus ou moins désertiques de la perversion réelle, constitue un mouvement heureux pour l’esprit.
– Ce texte par ailleurs, dans une rubrique que je n’aurais peut-être pas posée comme celle du « Dédale passionnel instruit des fantasmes des amants » mais plutôt dans celle de la « névrose » d’une manière générale (mais les amants dans le monde libéral dégagent davantage d’affects névrotiques que de signes absolument passionnels), présente une formule du narcissisme qui me semble particulièrement probante pour définir les positions de la névrose capitalistique : consomption hystérique et convulsive, récupération obsessionnelle et compulsive, qui me semblent respectivement bien représentées par les formules de l’ « alter-égoïsme » et de l’ « égo-altruisme », avec peut-être une petite tendance pour mon intuition à en inverser les formules : « soi au travers d’autrui » pour la première, et « autrui à travers soi » pour la seconde. Mais cela ne participe que d’une « intuition » personnelle.
– Enfin et peut-être plus encore que ne me semble importer les remarques précédentes, il faudrait discuter ici la structure très «lacanienne» de l’être proposé, et reposant sur les trois consistances de l’imaginaire, du réel, et du symbolique, ici le « vécu », le « rêvé », et le « pensé », dans une version donc renouvelée, et qui comporte toute sa pertinence. Je voudrai cependant rester prudent à l’endroit de ce mythe ou de ce phantasme de la structure d’un monde à trois registres « noués » entre eux de façon symétrique, chez Lacan, mais aussi dans le système qui nous est ici présenté. Je ne pense pas qu’on puisse mettre le réel sur les mêmes plans logiques que la dimension imaginaire du rêve, ou que la consistance symbolique de la pensée et de la connaissance. Que les trois instances soient à l’œuvre en tout être parlant ne fait aucun doute pour moi. Mais il y a une position d’antécédence du réel, ou une position du réel comme conditionnant les autres instances, qui me semble incontestable, et qui n’apparaît ni dans la théorie de Lacan ni ici. Je crois que c’est ce qui fait de ces visions extrêmement esthétiques, le côté un peu détaché à l’endroit du réel, ayant pour effet corollaire de passer sous silence, l’ensemble des réalités politiques qui conditionnent, elles, bien réellement, la possibilité d’un tel discours, le discours du sujet, pour le sujet, au sujet du sujet, attendant du sujet le salut du sujet, et restant bien sûr toujours sujet à discussions, puisque la machine intellectuelle de représentation et d’érotisation du « sujet », permet d’aligner un ensemble de formules qui marchent toujours assez bien, et peuvent faire école ou rester dans leur isolement ‘pathologique », mais qui ne sont par contre pas spécialement propices à contester dans l’école, la légitimité des dogmes intellectuels de l’école, qui sont aussi déterminants des cycles et des styles de comportements attendus des écoliers par les scholarques. Il peut y avoir là à l’œuvre une marque de ce que j’appelais sur les bases de la même idée lacanienne un peu confuse, dans mon texte d’avant 2002 sur la critique paranoïaque du jugement, le « refoulement du politique par la psychanalyse » (voir ici autocitation dans mon texte : temps de rôle et temps de parole.)
Je veux rappeler par là une critique qui s’adresse dans les faits et dans les intentions à la vision du monde lacanienne, qui est en train de s’éteindre petit à petit après s’être pas mal étendue, ce qui n’est pas un drame, au bénéfice de nouvelles structures de la pensée qui sont la plupart du temps infiniment moins belles et « compréhensives » que celle présentée ici par Laurent Derobert, dont encore une fois, je ne fais ici une critique formelle que sur un élément à mon sens « discutable », et pour le plaisir de le discuter, d’autant que lui propose ici quelque chose qui n’a apparemment pas vocation à faire école, mais plutôt de proposer une éthique qui me semble plus proche de celle de Spinoza que de celle de Françoise Dolto ce qui donne de l’air
(…)
2011 – Entretien avec Alain Berland
(Revue Questions d’artistes)
Alain Berland (AB) : Comment s’est mis en place le désir de développer un modèle mathématique lié à l’existentiel ?
2011 – ce qu’en pense Ben Harsiflout
Aborder les fragments de mathématiques existentielles à partir d’un point de vue intentionnaliste – dont l’ambition fort discutable consiste toujours à spéculer sur l’intention supposée de l’auteur – me semble être une entreprise peu séduisante, au motif qu’elle ne repose que sur une gentille et très banale quête de sens, et, donc, sur une demande de réconciliation bien improbable avec un objet textuel qui, de par sa souveraine indifférence à la question de sa légitimité, tirera durablement la langue à toutes nos approches définitoires. J’ose à peine l’avouer : il m’arrive rarement de demander à un tremblement de terre l’intention théorique ayant présidé à son émergence.
2010 – Comment optimiser son dédale ? (Image des Mathématiques) par Thierry Barbot
Comment optimiser son dédale ?
Pr Thierry Barbot (Université d’Avignon)
Peut-être certains d’entre vous, lors d’une visite à Avignon, ont remarqué avec grande surprise lors de son entrée au délirium, lieu notable de concert, certaines formules, comme par exemple…
2010 – La mesure du bonheur (Revue Tangente) par Edouard Thomas
Peut-on mesurer le bonheur ? Et si le concept de « dédale » introduit par l’auteur le permettait ? La formule du bonheur donnée, une « axiomatique des mathématiques existentielles » est proposée et une théorie est déroulée avec rigueur… et humour.
2010 – Équations philosophiques et poétiques
(La voix impertinente)
Entre philosophie et mathématiques, Laurent Derobert propose une modélisation de l’identité du sujet. Un langage universel – les maths – associé à des haïkus, pour parler de nos états d’êtres. A chaque équation, sa dimension poétique : amplitude des errances de l’être rêvé… Indice d’élasticité éthique… Force d’attraction de l’être rêvé… Inconstance de l’altruisme… Fort d’un parcours universitaire riche – Hypokhâgne et khâgne à Lyon, licence de philosophie et maitrise de sciences économiques à Aix-en-Provence, doctorat de sciences économiques – Laurent pose ici les bases d’une mathématique de l’être. Ce cultivateur d’idées nous emmène sur des rivages que nous n’aurions même pas imaginé…